L’histoire que je vais vous raconter date de presque cinquante ans. À part moi, tout les protagonistes sont morts depuis longtemps. Mais quel bonhomme que ce Robert Ariès.
Un premier paradoxe apparaît immédiatement à propos de Robert Aries. Lui qui prenait tout le monde en photo avec l’appareil qu’il gardait en permanence dans sa poche, n’a laissé aucune image de lui. Ni sur Google, ni dans les nombreux albums photos que je possède depuis des décennies, aucune image n’existe de lui. Il prenait des photos en tendant le bras pour inclure la scène dans son image. Si on remplace ses minuscules appareils achetés au Japon, on peut considérer qu’il avait inventé le selfie … Il possédait des milliers de photos en compagnie de mille personnes importantes. Personne ne possédait de photos de lui.
Et pourtant, je le vois encore comme si je l’avais rencontré hier, en 1970 …
C’était un homme d’une cinquantaine avancée, le front dégarni et des cheveux gris bien collés sur le côté du crâne. Un visage rond, avec des yeux pétillants et un sourire permanent donnant l’impression de se moquer de tout. Robert Aries était petit, bedonnant, diabétique et gourmand. Il donnait ses rendez vous dans de bonnes maisons, des pubs anglais où il occupait un fauteuil isolé, entouré de Coca Cola et de cacahuètes destinés à soigner sa glycémie. Vêtu d’un éternel costume gris et d’une chemise pas tout à fait propre, il semblait toujours revenir d’un long voyage. On le disait français, mais il était, en fait, un mélange de Hongrois et d’Américain.
Il avait une voix à la fois profonde et aiguë, accompagnant son accent américano-hongrois et une tendance évidente à la rigolade. Robert adorait rire des mauvais coups qu’il envisageait de jouer aux plus grandes multinationales. Je ne l’ai vu que deux fois ne pas avoir tendance à rire.
Le père d’un de mes amis, président d’un grand laboratoire pharmaceutique, prenant l’apéritif avec tout son staff après une randonnée à vélo où j’avais fait la démonstration de mon exécration churchillienne pour le sport, me montra du doigt en déclarant : « … et ce petit salaud est un ami de Robert Aries ! ». Et tous ces cadres supérieurs d’une multinationale de me demander de leur parler de Robert Aries, de m’interroger sur les mille légendes qui l’entouraient. Je pris un grand plaisir à cultiver le mythe de ce personnage facinant, mystérieux et dangereux.
La première fois que je le vis, il était invité chez mon père. Il était venu accompagné de sa compagne, Jacqueline, avec laquelle il ne s’était jamais marié. Probablement en raison d’un mariage ancien, aux Etats Unis dont il gardait une fille qu’on voyait de temps en temps. Jacqueline, qu’il appelait Cat, et avec laquelle il se montrait d’une remarquable muflerie, était une petite femme nerveuse qui passait son temps à le houspiller. Il n’en avait cure et s’enfilait des whiskies coke et des amuse gueule tout en parlant de tout et de rien avec mes parents. Un jour, sa famille s’agrandit d’un chihuahua minuscule qu’il transportait dans sa poche avant que le cabot, au bout d’un ou deux ans ne devint obèse.
Il vint nous retrouver à Avoriaz. Autant dire qu’il n’avait aucune disposition pour le ski. Mais dans un de ses gestes de générosité inopinée, il loua un petit avion pour nous emmener faire le tour du Mont Blanc. Une expérience assez forte, avec un décollage sur le bord de la falaise qui surplombe Morzine, puis un vol stationnaire face aux Grandes Jorasses.

Puis, profitant de mon goût pour le dessin et de ma jeune expertise en matière de logos (c’était mon sujet de maîtrise, inspiré par mon père, lui-même conseil en marques et en brevets), Robert me suggéra de lui dessiner toutes sortes de logos comportant impérativement deux X. Il m’expliqua longuement qu’il s’agissait d’une marque qui pourrait s’appeler Maxxal, Maxxon, Mexxon, Exxal, Exxon … Il me recommanda aussi d’utiliser de préférence du rouge et du bleu.

Peu de temps après, il lança toute une gamme de colliers insecticides pour chiens revêtus de mes créations, cela pendant que la Standard Oil changeait son nom d’Esso en Exxon. C’est ainsi que je fis connaissance avec la principale occupation de Robert Ariès que la justice américaine décrivit comme le délit de concurrence parasitaire. Son sport favori consistait à déposer des variantes de brevets de produits chimiques déposés par de grandes compagnies et de leur réclamer des droits, du fait que, lui, utilisait ces brevets pour ses colliers insecticides pour chiens. Entre autre qualité, Robert Ariès était un chimiste chevronné.
Tous les ans, Robert Ariès faisait au moins une fois le tour du monde pour recueillir les dividendes de ses actions. Il passait par tous les pays possibles à l’exception des États Unis où sa moindre apparition l’aurait conduit en prison depuis que Merck, un énorme laboratoire, était parvenu à le faire condamner. Quand il revenait en France, les bras chargés de cadeaux, son portefeuille était bourré d’une épaisses liasse de très gros billets. Robert Ariès n’avait pas de compte en banque, pas de carte de crédit, pas de véritable identité en France. Il habitait chez Jacqueline. Tout était au nom de Jacqueline…

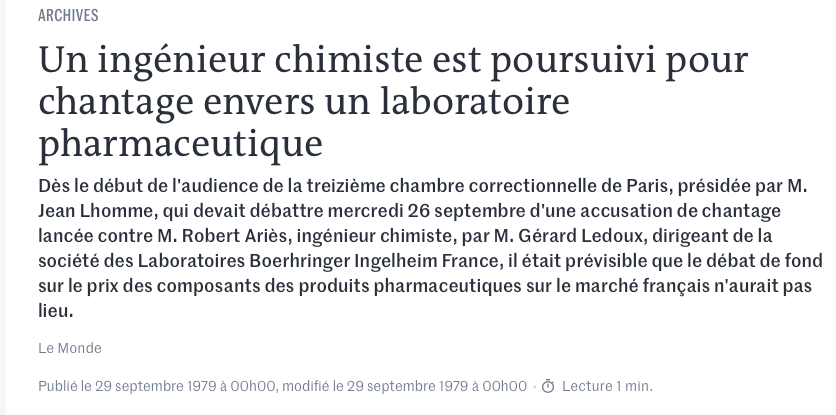
Quand on allait chez eux, la première chose qui frappait le regard était une énorme pile de courrier non ouvert. Robert expliquait qu’il n’existait personne qui pût lui envoyer un courrier qui l’intéressa. Donc il n’ouvrait rien, mais gardait tout.
Un jour, il me confia une enveloppe et me demanda d’aller la porter à l’adresse indiquée et de la remettre en main propre. Dans ma grande naïveté qui est à la source de tous les courages, je m’exécutai et j’allai remettre cette enveloppe dans les mains de Simone Veil, ministre de la santé. C’était une leçon que je n’oublierais pas : quand on veut, tout est possible.
Je préparai mon doctorat quand il me fit une proposition singulière :
« Pascal, vous devriez faire un doctorat en économie de la santé !
– Mais, Robert, je ne connais rien à l’économie, ni rien à la santé.
– Ce n’est pas important, il vous suffit derédiger un document de cinquante pages et de le présenter. Je vous aiderai. »
Il insista beaucoup et renonça. Deux ans plus tard, un de ses autres poulains que je tenais pour un idiot parfait fut interviewé à la radio : » nous avons interrogé monsieur Machin, docteur en économie de la santé ». Le type pontifia sur des banalités et, moi, je compris qu’il faut parfois écouter les conseils d’une personne qui connaît mieux le monde que le commun des mortels.
Pendant plusieurs années, il me confia de menues missions de recherche, d’illustration, de création. Il m’envoyait à l’office des brevets explorer les fichiers de dépôts. Il confiait à mes voisines anglaises des travaux de traduction qu’il payait quand il avait le temps. Nous nous rencontrions souvent dans les pubs sombres qu’il affectionnait et où il se gorgeait de Coca Cola et de cacahuètes. Il me payait parfois d’un billet ou, parce que je le convoitais, d’un magnifique appareil photo miniaturisé tout droit arrivé du Japon.
Robert Ariès ne se passionnait pas seulement pour le monde de la chimie et de la pharmacie, où il jouait le rôle de croquemitaine. Il était aussi passionné d’art. C’est ainsi qu’il avait tout doucement accumulé toute l’oeuvre de Fujita, dont la rareté entretenue par ses soins faisait grimper la cote de manière exponentielle. Il entretenait aussi des relations ambiguës avec quelques faussaires fameux dont je soupçonne qu’ils contribuèrent à enrichir sa collection.
Un jour il offrit une madone de Fujita à mon père. Juste comme ça.

Il faut dire qu’il n’avait jamais eu confiance dans les talents de mon père et qu’il avait confié ses principaux comptes de brevets et de marques à des concurrents de ce dernier. Leur amitié grandissant, il se rattrapait en de menus actes de générosité pour combler le manque à gagner de mon paternel. Plus tard, j’ai hérité du Fujita …
Comme je l’ai déjà dit, Robert Ariès était d’une incroyable grossièreté avec Jacqueline qui passait la majeure partie de sa vie à s’inquiéter pour lui et ses exactions. Sa muflerie ne l’avait pas empêché de mettre toutes ses possessions au nom de Jacqueline, ce qui le rendait absolument intouchable par le fisc, puisque cette dernière n’était pas mariée avec lui et n’entretenait aucun lien officiel avec lui. Jacqueline investissait la majeure partie de l’argent que lui confiait Robert dans sa passion pour les chevaux de course. Cela n’intéressait absolument pas Robert qui compensait ses manières indélicates par une générosité indulgente pour les pertes que causait sa passion hippique.
Oui, mais voilà, Jacqueline était devenue dépressive. On l’eût été à moins. Un jour il y eut une crise un peu plus intense que les autres et Jacqueline sauta du dixième étage. Arrivée au sol, Robert Ariès n’avait plus rien, pas même de domicile. Ses collections étaient envolées et, surtout, son ange gardien avait disparu.
Quelques semaines plus tard, alors que je me rendais chez mon père, il m’aborda sur le boulevard Bineau à Neuilly. Lui, qui n’avait jamais été un modèle d’élégance avec ses costumes gris aux poches bourrées de gadgets, était ouvertement sale, il semblait avoir couché dehors. Son visage défait avait maigri et ses yeux s’étaient éteints. Il me demanda de l’accompagner pour qu’on parle. Je refusai, prétextant que j’étais en retard et qu’on m’attendait. Je regrette encore ma lâcheté.
Un ou deux ans plus tard, une relation commune de Robert et de mon père, parlèrent une dernière fois de lui. « Oui, je l’ai vu, il fait la manche à New York … »

PARIS, March 1 — Robert Aries, whose profitable hobby is to pick up any valuable patents and trademarks that aren’t nailed down, has a “mexxage” for the Standard Oil Company (New Jersey).
At a cost estimated at anywhere up to: $100‐million, the company is engaged in transferring its customers’ loyalties frdm Esso, Humble, and other trademarks to Exxon.
In an original lithograph he is mailing to Jersey Standard executives, Mr. Aries said today, he is breaking the news that he may have prior claim in many countries to the name Exxon and scores of deratives.
Mr. Aries recalled in an interview that he had filed the name Chimexon as early as 1965. This was during the epic, trademark raid, when he registered in Monaco hundreds of famous names, such as Morgan, Chase, Mellon, Goodrich, C.B.S. and Seagram.
Most of the American owners of these names, it developed, had not bothered to register them on the Continent. Under international conventions, Mr. Aries could and did file a. claim to the names for many countries.
When the dust settled, Mr. Aries had voluntarily withdrawn many of his trade names and sold a few, he says he still occasionally turns a penny on one of them. Meanwhile, he ended his most troublesome litigation, with Merck & Co., by dropping his claim to an antibiotic for chickens. Merck in turn dropped its efforts to put Mr. Aries in jail, though it had the satisfaction of having obtained a damage judgment of $21‐million in the case — a record at the time, though uncollectible.
Mr. Aries, a French citizen who once taught chemistry in Brooklyn, did not abandon the field. With income from two small chemical plants and his royalties, he seems to be earning enough money to indulge his special interests, which include methods for detecting the doping of horses and the faking of pictures.
He files about 100 trademarks and 70 pattents a year, he estimated, His research. technique is similar in both cases. For example, when a new and promising patent is filed, the chemist sits at his desk and works out a “rearrangement of molecules” that will produce competitive results.
Then he patents his plan.
“We’ve been lucky,” he said modestly. “One out of two of these ‘paper patents’ turns out to be good. We think it’s cheaper than to do research… It’s invention, just the same.”
In the trademark field, Mr. Aries has often publicly chided industry for negligence in protecting its property. The law is full of loopholes: A name may be registered for one product or service but not for another, or in one country but not all.
American companies are particularly vulnerable, he explained, because a trade name must, be used to be claimed, whereas in most other countries, simple filing is enough, ‘within some time limits. Jersey Standard did get around to filing’ Exxon in many countries last fall and this winter, it seems, but Mr. Aries thinks he got there first.
Jersey Standard appears to have spent years looking for a name under which to consolidate its various labels. Under a 60‐year‐old antitrust verdict,‐it could not use Esso everywhere. So it chose Exxod.
As an expert, Mr. Aries thinks this was a pity. “Esso is the best American trademark since Coca‐Cola,” he said.
Nevertheless, last May 19 Mr. Aries filed the name Exona for chemical products, in Monte Carlo. He contends this gave him a priority date, on ‘the ground of phonetic similarity.
Jersey Standard Taking ‘Steps’
A spokesman for Jersey Standard said in New York yesterday:
“The Exxon trade mark is registered in France and elsewhere in the world where Jersey affiliates operate. We have title to the. Exxon trade mark and we are confident that our rights to it are protected.
We are familiar with Mr. Aries’ activities and we are taking appropriate steps to protect our interests.”
Cet article, qui contient son lot d’erreurs et de légende, est le reflet de cette détestation admirative que suscitait toujours Robert Ariès qui semait la terreur dans l’industrie et les offices de propriété intellectuelle.
Robert Ariès me laisse un souvenir ambigu fait d’une admiration sans borne pour un homme qui faisait éclater les règles de la bienséance capitaliste et une répulsion mitigée de regrets pour un homme qui a travaillé activement à sa propre ruine. Sa disparition presque totale de notre monde me chagrine et me rend perplexe sur la gloire des hommes.
Il m’a laissé une force inexpugnable : celle d’oser.
S’il m’a aussi laissé l’instinct de déceler les instincts malfaisants chez ceux avec qui j’ai des relations d’affaire, il m’a appris à leur faire la peau avec une cruelle insolence, avec son rire de vieux vampire. Cet homme venu des bas fonds des années cinquantes m’a aussi appris à aider, soutenir, motiver ceux chez qui je vois un avenir.

Bonjour,
Non, tous les protagonistes ne sont pas morts !
J’ai rencontré Robert Aries en 1979. J’ai travaillé pour lui. Si je n’ai pas sauté du dixième étage, c’est que mon agence de publicité, qu’il avait pour ainsi dire prise en otage, avait ses bureaux en rez de chaussée. Le décès hier de Maître Henri Leclerc, m’a rappelé les heures glorieuses et sombres de cette drôle de rencontre.
A vous re-lire.
J’aimeJ’aime
Bonjour,
désolé de vous avoir involontairement enterré !
Était-ce en France ou aux États Unis ?
Avez-vous une photo de lui ?
Il a disparu de mon existence en 76 ou 77, je ne suis plus sûr.
Je doute qu’il soit encore vivant, mais vous me confirmez son extraordinaire capacitée de survie en dépit de toutes les circonstances.
Amicalement
J’aimeJ’aime
Merci de votre retour si rapide.
J’ai rencontré Robert Aries en 1979, à Paris. Il était en pleine campagne d’actions contre les compagnies pharmaceutiques multinationales. Mon agence de publicité a été pour lui un formidable vecteur d’attaque.
Peut-on poursuivre de vive voix ? si oui, comment puis-je vous joindre ?
J’aimeJ’aime
Appelez moi au 0608924946
J’aimeJ’aime